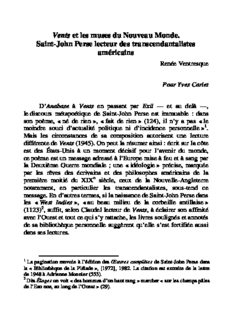
Vents et les muses du Nouveau Monde. Saint-John Perse lecteur des transcendantalistes américains PDF
Preview Vents et les muses du Nouveau Monde. Saint-John Perse lecteur des transcendantalistes américains
Vents et les muses du Nouveau Monde. Saint-John Perse lecteur des transcendantalistes américains Renée Ventresque Pour Yves Carlet D’Anabase à Vents en passant par Exil — et au delà —, le discours métapoétique de Saint-John Perse est immuable : dans son poème, « né de rien », « fait de rien » (124), il n’y a pas « le moindre souci d’actualité politique ni d’incidence personnelle »1. Mais les circonstances de sa composition autorisent une lecture différente de Vents (1945). On peut la résumer ainsi : écrit sur la côte est des États-Unis à un moment décisif pour l’avenir du monde, ce poème est un message adressé à l’Europe mise à feu et à sang par la Deuxième Guerre mondiale ; une « idéologie » précise, marquée par les rêves des écrivains et des philosophes américains de la première moitié du XIXe siècle, ceux de la Nouvelle-Angleterre notamment, en particulier les transcendantalistes, sous-tend ce message. En d’autres termes, si la naissance de Saint-John Perse dans les « West Indies », « au beau milieu de la corbeille antillaise » (1123)2, suffit, selon Claudel lecteur de Vents, à éclairer son affinité avec l’Ouest et tout ce qui s’y rattache, les livres soulignés et annotés de sa bibliothèque personnelle suggèrent qu’elle s’est fortifiée aussi dans ses lectures. 1 La pagination renvoie à l’édition des Œuvres complètes de Saint-John Perse dans la « Bibliothèque de la Pléiade », [1972], 1982. La citation est extraite de la lettre de 1948 à Adrienne Monnier (553). 2 Dès Éloges on voit « des hommes d’un haut rang » marcher « sur les champs pâles de l’Eau nue, au long de l’Ouest » (29). Saint-John Perse ne découvre pas le transcendantalisme en arrivant aux États-Unis. Comme Proust et Gide, et avec le même enthousiasme qu’eux, Alexis Leger a lu au tout début du XXe siècle Feuilles d’herbe de Whitman, Sept Essais et La Conduite de la vie d’Emerson, Walden ou la vie dans les bois de Thoreau3. Il y a appris à respirer librement, à révérer la poésie, à identifier la merveille à ce monde même. L’exil aux États-Unis élargit les lectures transcendantalistes de Saint-John Perse — il lit Les Forêts du Maine de Thoreau — et les revivifie. Ainsi l’été qui lui fait fuir Washington pour rejoindre les Biddle à Wellfleet, Massachusetts, le met sur les traces de Thoreau qui arpentait le Cap Cod moins de cent ans plus tôt. En vacances chez eux ou chez Mina Curtiss ou Béatrice Chanler, tous des intellectuels et/ou des écrivains, il a le loisir de puiser dans leur bibliothèque. Les allusions à Moby Dick dans ses « Lettres d’exil » indiquent qu’il ne s’en prive pas4. Aux États-Unis Saint-John Perse lit aussi les journaux. Moins d’un an après son arrivée, il découpe à quelques jours d’intervalle, les 2 et 15 juin 1941, dans Time et dans The New York Times Book Review, deux comptes rendus de l’ouvrage pionnier que le critique Francis Otto Matthiessen vient de consacrer à la littérature américaine des deux premiers tiers du XIXe siècle, La Renaissance américaine5. Des photographies de Whitman, Emerson, Thoreau, Hawthorne et Melville illustrent l’article du New York Times. Le dossier intitulé « Maine et "Seven Hundred Acre Island" » dans les archives du fonds américain de la bibliothèque de Saint-John Perse contient d’autres articles également prélevés dans des revues littéraires, par exemple celui de Gerald Carson sur le livre de 3 R. Ventresque, Saint-John Perse dans sa bibliothèque, Paris : Honoré Champion, 2007. Pour la réception de l’œuvre de Thoreau en France, M. Gonnaud, « Sur la pointe des pieds » : la réception de Thoreau en France », Cahiers de L’Herne, Sous la direction de M. Granger, 1994, p. 309-318. 4 R. Ventresque, op. cit., p. 251-252. 5 R. O. Matthiessen, American Renaissance : Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman, New York, Oxford University Press, 1941. Thoreau, Cap Cod, etc. La lecture qu’on propose ici de Vents prend en compte ce matériau livresque. Si l’on en croit Thoreau, marcher vers l’Ouest lui est naturel. Veut-il se promener ? Son « instinct » le conduit « inévitablement » dans cette direction : « Je dois me forcer pour aller à l’Est, mais à l’Ouest je vais de mon plein gré », constate-t-il dans De la marche 6. À l’Est, précise-t-il, il y a les villes et la civilisation : « [n]ous allons vers l’Est pour appréhender l’Histoire et étudier les œuvres d’art et de littérature, en remontant les traces de la race ». La « Ville haute » au Chant IV de Vents est bien le premier symbole de la civilisation occidentale que le « Voyageur » rencontre sur le chemin de son retour vers l’Est (IV,4, 243). Thoreau ajoute : « Nous allons vers l’Ouest comme vers le futur, avec un esprit d’entreprise et d’aventure » parce que « la terre semble plus inépuisée et plus riche de ce côté ». Au Chant II de Vents ceux qui vont « la face en Ouest » (II,1, 200) atteignent des « terres neuves ». Elles ont « comme un parfum de chair nubile et forte au lit des plus beaux êtres de ce monde » (II,1, 199). Cette prédilection des uns et des autres pour l’Ouest n’est pas vraiment naturelle ni surtout nouvelle. L’Ouest de Vents représente, selon l’auteur du Soulier de satin et du Livre de Christophe Colomb qui s’y connaît, « la vraie patrie des hommes de désir » (1123). Et de citer l’illustre Génois auquel il compare Saint-John Perse. Cependant le « Voyageur » de Vents qui traverse le continent d’un Océan à l’autre — IV,5, 245 : « herpes marines et ambre gris, autres merveilles atlantiques », et IV,2, 237 : « Mer Pacifique… ô mer de Balboa ! » — a sûrement des modèles plus immédiats. Par exemple les explorateurs Lewis et Clark. Partis de Virginie en 1804, ils furent les deux premiers Américains à gagner la côte du Pacifique avant de revenir vers l’Est en 1806. Saint-John Perse est trop friand de récits de voyage pour ignorer cette étape pionnière de la connaissance, puis de la conquête de l’Ouest — voir dans Vents le folklore du 6 H. D. Thoreau, De la marche, Cahiers de l’Herne, op. cit., p. 92. Far West : « et la ronce de fer aux abords des corrals, et la forge de plein air des marqueurs de bétail » (I,3, 185). L’expédition de Lewis et Clark et les autres qui l’ont suivie au cours du XIXe siècle ont eu, bien avant l’invention cinématographique du western, un retentissement extraordinaire sur l’imaginaire américain, celui singulièrement des transcendantalistes7. Contemporains, sinon partisans, de la politique jacksonienne d’expansion territoriale, Emerson, Thoreau et Whitman ont vu en quelques années la frontière de l’Ouest toucher le Pacifique, la population des villes exploser sous l’afflux des immigrants, etc. Ils ont été attirés, fascinés même, par la « contrée la plus neuve du Nouveau Monde »8. Le déploiement vers l’Ouest qui offrait aux qualités physiques, et surtout spirituelles, des pionniers la possibilité de s’accomplir et de se dépasser, est devenu pour eux l’aventure humaine par excellence9. Dans un passage célèbre de Feuilles d’herbe Whitman l’exalte ainsi10 : O vous, jeunes gens, jeunes gens de l’Ouest, Si impatients, si avides d’action, si pleins de mâle fierté et d’amitié, Je vous vois nettement, ô jeunes gens de l’Ouest, je vous vois cheminer à l’avant-garde de la race, Pionniers ! ô pionniers ! 7 Voir par exemple E. Fussell, Frontier : American Literature and the American West, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1965, et l’ouvrage récent de Kris Fresoncke, West of Emerson. The Design of Manifest Destiny, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2003. 8 Y. Carlet, « Emerson and the West : the metamorphoses of the great and crescive self’ ». Y. Carlet qui m’a amicalement communiqué son article rédigé en anglais, n’a pu en retrouver les références. 9 Quitte à déchanter assez vite. Emerson et Thoreau notamment ont dénoncé les exactions commises à l’Ouest par les pionniers. Voir Vents III,2, 219 : « Et puis vinrent les hommes d’échange et de négoce. Les hommes de grand parcours gantés de buffle pour l’abus ». 10 W. Whitman, « Oiseaux de passage » dans Feuilles d’herbe, Aubier, [1972], 1989, p. 319. Emerson, lui, identifie l’Ouest à « une fontaine de jouvence » : l’Ouest est « une promesse de renaissance »11. Nous ne sommes pas loin de la géographie spirituelle de Vents. De là à croire que « l’Amérique est faite pour l’homme de l’Ancien Monde »12, comme le fait Thoreau dans De la marche, il n’y a qu’un pas. Les transcendantalistes le franchissent d’autant plus volontiers qu’ils sont eux-mêmes les héritiers, avoués ou non, de l’eschatologie millénariste des puritains du XVIIe siècle13 pour qui l’Amérique est un don de Dieu. Au Chant III de Vents « les grands Réformateurs » qui portent « souliers carrés et talons bas, chapeau sans boucle ni satin, et la cape de pli droit » (III,2, 219), semblent directement venir de La Lettre écarlate de Hawthorne. Les « Pères Pèlerins » étaient convaincus, comme le rappelle Mircea Eliade dans La Nostalgie des origines14, que « le drame final de la régénérescence morale et du salut universel commencerait avec eux » puisque, les premiers, ils avaient « suivi la route du soleil dans sa course vers les jardins paradisiaques de l’Ouest ». Pour Thoreau en particulier, le « Soleil » est « le Grand Pionnier de l’Ouest que suivent les Nations », et l’Amérique, l’espace sans concurrence où, lavé des péchés de Babylone, entendons l’Angleterre, et au delà, l’Europe, l’homme atteindra « une perfection plus grande tant sur le plan intellectuel que physique ». Évidemment Saint-John Perse n’a aucune inclination pour l’eschatologie puritaine. Rien n’est plus étranger aux « Puritaines » qu’il apostrophe au Chant II (4, 208) que son « désir, qui v[a] chanter, sous l’étirement du rire, et la morsure du plaisir » (I,6, 193). Pour autant sa vision laïque et sensuelle de l’Amérique n’est pas moins enthousiaste que celle des transcendantalistes. De retour en 11 Y. Carlet, art. cit. 12 H. D. Thoreau, op. cit., p. 94. 13 C’est la « Destinée manifeste ». Voir entre autres K. Fresoncke, op. cit. 14 Mircea Eliade, La Nostalgie des origines, Paris : Gallimard, collection Idées, [1969], 1971, p. 173. 1947 d’un voyage sur la côte est, il en parle à Francis Biddle comme d’un « beau corps de femme » qu’il a parcouru « de la tête aux pieds »15. En tout cas pour tous, transcendantalistes ou pas, l’Amérique constitue « un incomparable matériel ». Dommage, regrette Emerson dans son essai « Le Poète » — Alexis Leger l’a lu en 190816 —, qu’elle n’ait pas encore trouvé un chantre à sa mesure17 : Nous n’avons pas encore eu, en Amérique, de génie, au regard tyrannique, qui ait compris la valeur de notre incomparable matériel […] Nos échanges abusifs de faveurs, nos estrades politiques, nos pêcheries, nos Noirs et nos Indiens, nos vantardises et nos reniements, la colère des marginaux et la pusillanimité des gens honnêtes, le commerce du Nord, les plantations du Sud, le défrichement de l’Ouest, l’Oregon et le Texas n’ont pas encore été chantés. Et, pourtant, l’Amérique est un poème à nos yeux ; son ample géographie éblouit l’imagination et n’attendra pas longtemps pour être mise en vers. Emerson a raison d’espérer. Whitman ne va pas tarder à exaucer son vœu. À partir de 1855 Feuilles d’herbe chantera les bords de « l’Ontario bleu », le « bac de Brooklyn », le « cèdre de Californie », etc. On peut considérer qu’à sa manière Vents prendra le relais en 1945. Lorsque les transcendantalistes, et plus généralement les écrivains de la « Renaissance américaine » comme Hawthorne, chantent les louanges de l’Amérique, ils vilipendent dans les mêmes proportions la vieille Europe dont ils contestent au nom de l’identité nationale la tyrannie intellectuelle, et aussi économique, 15 Saint-John Perse et ses amis américains. Courrier d’exil, 1940-1970, Textes réunis, traduits et présentés par C. Rigolot, Cahiers de la Pléiade, n° 15, Paris : Gallimard, 2001, p. 144. 16 R. Ventresque, Saint-John Perse dans sa bibliothèque, op. cit., p. 25-38. 17 R. W. Emerson, Essais, L’intellectuel américain. L’art. Le poète, Michel Houdiard éditeur, 2000, p. 84. institutionnelle, etc. En 1834 l’essai d’Emerson, « Nature », inaugure avec panache l’indépendance de la littérature américaine18 : « Notre âge est rétrospectif. Il bâtit les mausolées de nos pères. Il écrit des biographies, des histoires et de la critique. Les générations précédentes regardaient Dieu et la nature en face ; nous le faisons à travers leurs yeux. Pourquoi ne pas jouir, nous aussi, d’une relation originale à l’univers ? Pourquoi n’aurions nous pas une poésie et une philosophie de pénétration plutôt que de tradition, ainsi qu’une religion qui soit une révélation et non l’histoire de la religion des pères ? […] Il y a de nouvelles terres, des hommes neufs, des pensées nouvelles. Exigeons nos propres œuvres, nos lois et nos cultes. » Sa conférence, « L’intellectuel américain », récidive en 1837 : « Cela fait trop longtemps que nous écoutons les muses courtisanes de l’Europe »19. Pour lui l’Amérique n’a rien à envier au Vieux Monde. Elle repose « sur les mêmes fondations merveilleuses que la ville de Troie ou le temple de Delphes »20. Feuilles d’herbe répercute le message21 : « Viens, Muse, émigre de Grèce et d’Ionie, Fais une croix, je t’en prie, sur ces comptes si largement payés, Cette affaire de Troie et du courroux d’Achille, et des courses errantes d’Énée, d’Ulysse, Affiche "Déménagé" et "À louer" sur les rochers de ton neigeux Parnasse. » Plus sobrement Thoreau affirme, toujours dans De la marche22 : Je dois marcher vers l’Oregon, et non vers l’Europe. 18 R. W. Emerson, Essais, Michel Houdiard éditeur, 1997, p. 13. 19 R. W. Emerson, Essais. L’intellectuel américain. L’art. Le poète, op. cit., p. 38. 20 Id., p. 85. 21 Désormais je cite Whitman dans l’édition de la collection nrf/Poésie, Paris : Gallimard, Poèmes, [1918], 1992, p. 125. 22 H. D. Thoreau, De la marche, op. cit., p. 92. Mais enfin Saint-John Perse ? Il est, lui, un « animal essentiellement français », d’« argile essentiellement française », « le produit le plus raffiné de la civilisation et de la culture françaises » (1249). Il le répète lui-même avec insistance et le fait écrire à ses amis américains. En quoi les griefs envers l’Europe des écrivains de la côte est le concernent-ils ? Force est pourtant de constater que Vents vise les mêmes cibles qu’Emerson, Whitman, Thoreau ou Hawthorne. En premier lieu le passé sous toutes ses formes. Saint-John Perse, note Katherine Biddle dans un texte que le poète a « inspiré », sinon écrit (1249), « tourne spontanément le dos à tout ce qui est révolu pour faire librement face au futur […] Nulle complaisance en lui, ni nostalgie pour les vestiges du passé ». Lui- même déclare dans Vents (I,6, 191) : « La condition des morts n’est point notre souci ». Dans le récit de Hawthorne, La Maison aux sept pignons, le « révolutionnaire » Holgrave s’interrogeait en 185023 : Ne serons-nous jamais débarrassés de ce Passé ? […] Il pèse sur le présent comme le cadavre d’un géant […] nous sommes les esclaves du Passé, ou, ce qui revient au même, de la Mort ! Whitman s’exclamait de son côté24 : Passé ! passé ! pour nous, à jamais passé, ce monde jadis si puissant, aujourd’hui vide, inanimé, fantôme […]. Rien ne symbolise mieux le passé que les bibliothèques, remplies qu’elles sont des « pensées des morts »25. Au feu donc les livres. Dans son conte fantastique, « Earth’s Holocaust » (1844), Hawthorne fait flamber au milieu d’un gigantesque bûcher la fine fleur de la littérature et de la philosophie européennes, Voltaire, Shakespeare, Milton, etc. Pendant ce temps, « ses vêtements couverts de la poussière des bibliothèques », un « rat de bibliothèque » 23 N. Hawthorne, La Maison aux sept pignons, Garnier-Flammarion, 1994, p. 202. 24 W. Whitman, Poèmes, op. cit., p. 126. 25 N. Hawthorne, « Earth’s Holocaust » dans Tales and Sketches, The Library of America, 1982. se lamente26 : « Oh, mes livres, mes livres chéris ! […] ». Le narrateur lui répond : « Mon cher Monsieur, […] la Nature ne vaut-elle pas mieux qu’un livre ? ». C’est l’avis d’Emerson dans « L’intellectuel américain ». Il y déplore, lui aussi et dans les mêmes termes, la transformation des jeunes gens en « rat[s] de bibliothèque »27. Pour sa part Vents voue « [l]es livres au fleuve » (I,4, 186) et promet à la démolition « la Basilique du Livre » (II,4, 186-187). Du reste Saint-John Perse ne s’arrête pas là. Il s’en prend aux « Palais d’Archives », aux « Hôtels de Ventes et de Transylvanie », et plus généralement à tous ces bâtiments administratifs que, de retour à l’Est, le Voyageur exècre comme autant de symboles des institutions désuètes : « Nous en avions assez […] », scande le Chant IV (5, 244-245). Là encore Holgrave, dans La Maison aux sept pignons, paraît avoir devancé Saint-John Perse : Je doute fort que nos bâtiments publics, palais de gouvernement, mairies, églises, doivent être bâtis en matériaux aussi durables que la pierre ou la brique »28. « Il vaudrait mieux », ajoute-t-il, « que tous les vingt ans environ, ils tombent en ruine, donnant au peuple l’idée d’examiner et de réformer les institutions qu’ils représentent, ou encore : Il semblait à Holgrave, comme à tous les enthousiastes de chaque siècle depuis Adam, que c’était à son époque que le passé moisi et tout recouvert de mousses allait s’écrouler, les vieilles institutions sans vie disparaître, et qu’un monde meilleur allait se bâtir sur leurs ruines détestables. 29 Rien n’échappe à cette volonté, plus ou moins ironique — au moins chez Hawthorne —, d’anéantir les réalisations du passé. Pas même les formes littéraires. Si Whitman condamne le « vieux roman » et les « vers d’amour sucrés de rimes »30, Saint-John Perse 26 Id., p. 901. 27 R. W. Emerson, « L’intellectuel américain », op. cit., p. 18. 28 N. Hawthorne, La Maison aux sept pignons, op. cit., p. 203. 29 Id., p. 199. 30 W. Whitman, Poèmes, op. cit., p. 131. n’a que dédain pour « l’ariette de boudoir » et autres « grâces mortes du langage » (IV,5, 246). La dette du poète de Vents à l’égard des transcendantalistes excède largement ces refus. Il leur doit en fait une bonne part de sa représentation anti-intellectualiste du monde. Mélange d’idéalisme néo-kantien et de romantisme européen, marqué à la fois par les textes mystiques de l’Inde et le messianisme calviniste, le transcendantalisme américain défie pour le moins toute définition31. C’est justement en cela qu’il séduit Saint-John Perse. On le sait rebelle depuis toujours aux systèmes, ferme sur son rejet du matérialisme, fidèle à sa confiance en l’intuition. En 1945 Vents condense spectaculairement les choix de ce lecteur d’Emerson et de Thoreau. Il y congédie la logique — « Je te licencierai, logique, où s’estropiaient nos bêtes à l’entrave » (III,5, 228) —, la démarche rationnelle et le savoir livresque. Il leur préfère les lois du cosmos qui garantissent le « renouement » de l’homme avec son milieu (III,4, 226) et « une plus haute connaissance » (I,5, 188). Il accueille les vents, les typhons et les orages « comme un souffle de promesses » (III,1, 217). Ce n’est pas le solitaire des bois de Walden qui le démentirait. Comme Thoreau encore, il appelle à la « dispersion » des « balises » et des « palissades » (I,3, 184), à l’« enlèvement de clôtures, de bornes » (I,6, 192), bref, de tout ce qui limite, donc emprisonne : « Et dispersant au lit des peuples, ha ! dispersant — qu’elles [« les grandes forces »] dispersent ! disions- nous — ha ! dispersant […] » (I,3, 184). Comme lui aussi, il renie, dans un mouvement perpétuel au delà, toute forme d’installation. Parmi « toutes choses descellées » (I,5, 190) le monde entier est en marche dans Vents : « les dieux […] marchent dans le vent » (I,6, 191 et I,7, 196), les terres sont « en marche vers l’Ouest » (II,2, 202), « de plus hautes crues en marche vers le large » (II,3, 206), etc. Toujours il s’agit de « [s]’en aller » (I,4, 187) et, sous 31 Y. Carlet : « Le transcendantalisme américain : comment le définir ? », Critique, n° 541-542, juin-juillet 1992, p. 535-547.
Description: